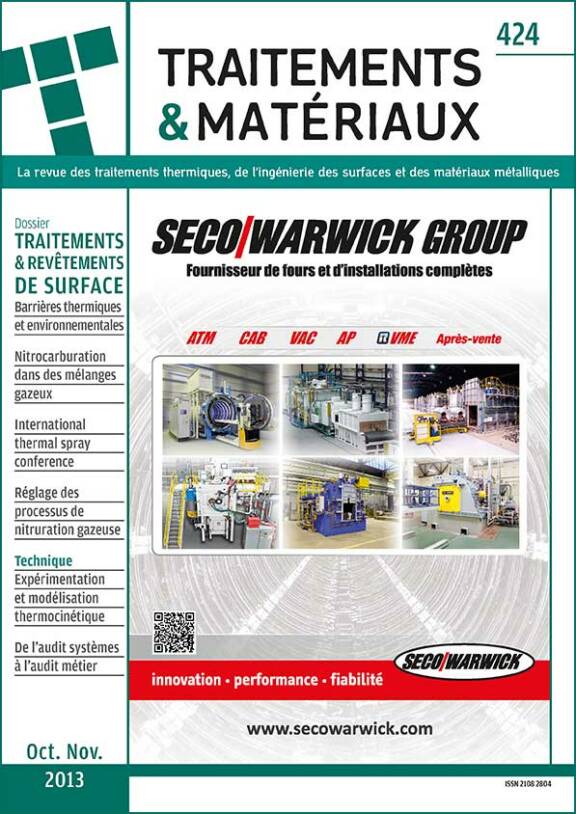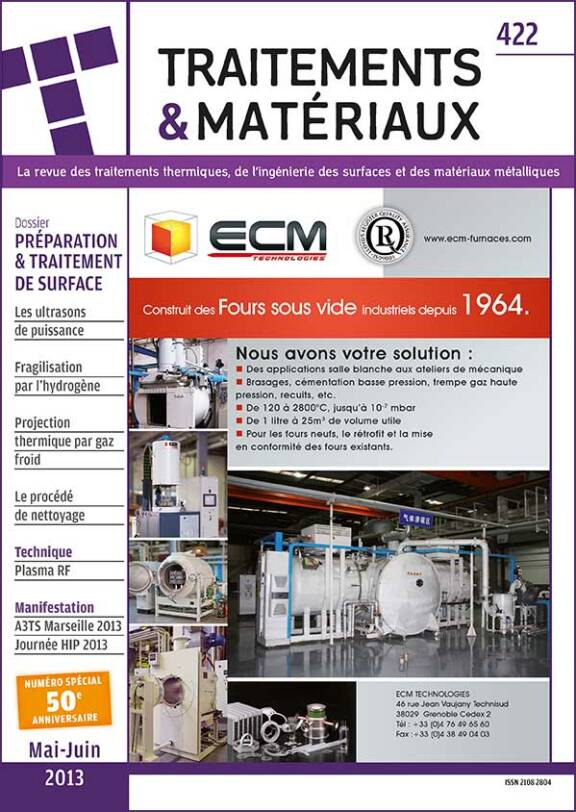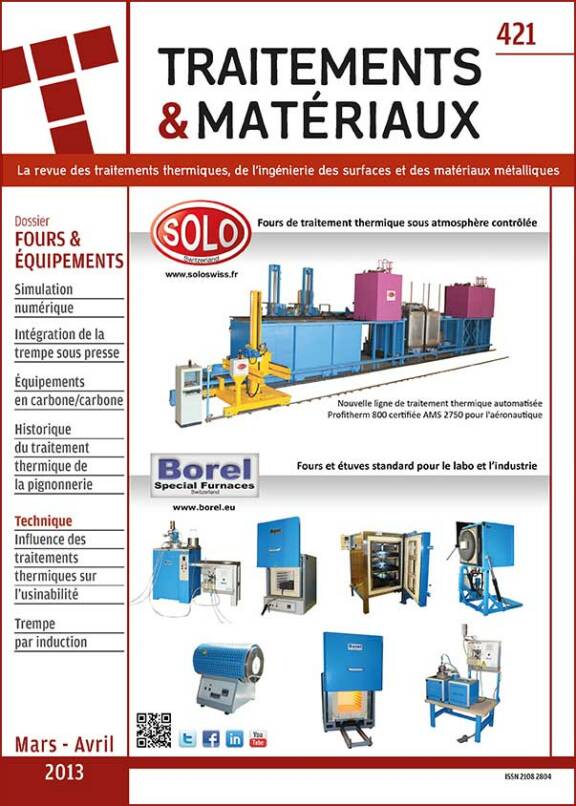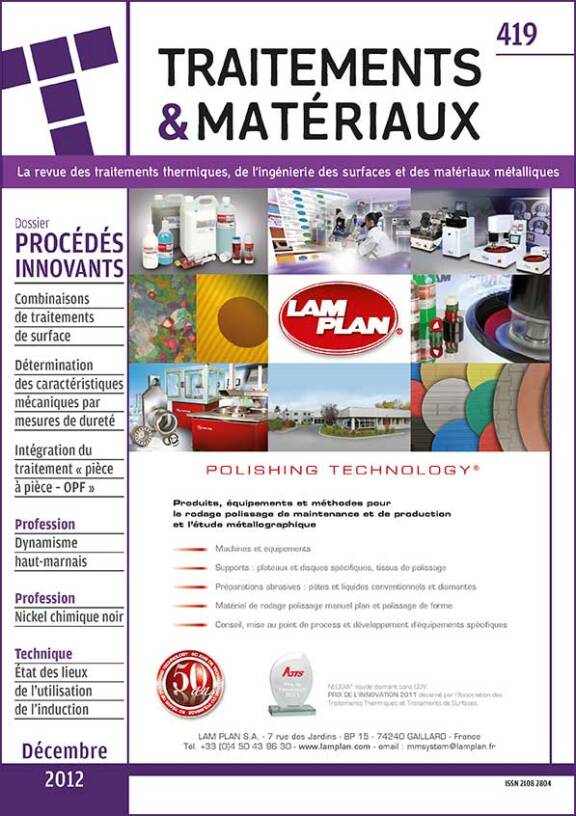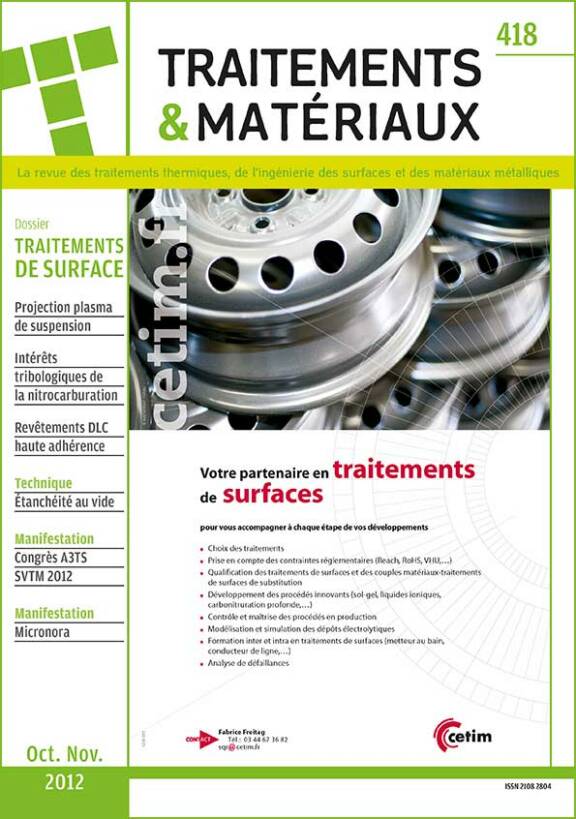Nos publications
-
N°424 - Octobre/novembre 2013
Inventer de nouvelles solutions matériaux
Il faut remonter aux années 70, période de lancement du programme électronucléaire français, de la construction des premières lignes TGV, de l’essor du programme spatial européen et de l’initiative européenne Airbus, pour voir se profiler des enjeux de développement et d’innovations technologiques dans le domaine des matériaux à la hauteur de ceux générés par les défis suivants : la mobilité décarbonée, le stockage de l’énergie, les éoliennes offshore géantes, les fermes hydroliennes, l’exploitation des ressources marines profondes… Chacun de ces programmes recèle en lui une myriade de rêves d’ingénieurs. Dans le même temps, on semble assister à une amorce de rééquilibrage de la production industrielle vers les économies avancées. Les Etats-Unis, dont les usines de montage automobile tournent à pleine capacité et dont l’industrie chimique investit massivement pour produire des produits chimiques de base, grâce une baisse des coûts de l’énergie induite par l’exploitation des gaz de schiste, en sont une illustration. L’industrie européenne doit elle, s’appuyer sur d’autres fondamentaux pour rebondir; l’innovation technologique et l’investissement industriel dans des filières portées par les tendances sociétales que sont l’énergie, l’environnement, la santé, l’alimentation sont des priorités sur laquelle l’Europe doit accélérer. Développer ces filières passe par l’invention de nouveaux matériaux et des traitements appropriés pour répondre aux conditions d’usage du futur : allègement des structures, efficacité énergétique, minimisation de l’impact sur l’environnement, adaptation à des conditions d’usage extrêmes. Les exigences de rapidité, l’impérieuse nécessiter de rester compétitif sur des marchés ouverts impose une généralisation des approches collaboratives en matière de développement associant grands groupes, ETI/PME et laboratoires ainsi qu’un recours accru au « cross fertilizing » entre secteurs industriels. Le congrès A3TS de Marseille 2013 a mis en avant les enjeux des traitements des matériaux à l’horizon 2020. Le prochain congrès A3TS qui se tiendra à Reims les 11 et 12 juin 2014 approfondira les sujets ouverts à Marseille et sera axé sur l’offre de traitements imposés par les conditions extrêmes ou aux limites de l’emploi des couples matériaux- traitements. J’attire aussi votre attention sur les journées européennes du traitement thermique qui auront lieu à Munich du 12 au 15 mai 2014 ; journées qui seront couplées avec le congrès mondial de l’IFHTSE. Un rendez-vous à ne pas manquer pour capter les tendances technologiques au-delà de nos frontières.
Pierre Bruchet, président de l’A3TS
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°423 - Septembre 2013
Une valorisation nécessaire de la profession
Dans un contexte de plus en plus marqué par les réglementations techniques et environnementales, notre profession a, depuis une bonne trentaine d’année, connu de nombreuses évolutions tant au niveau des procédés mis en œuvre que des substances utilisées. L’amélioration de l’image de la profession et la valorisation de ses efforts vis-à-vis des pouvoirs publics, des donneurs d’ordres et du grand public sont des actions sur lesquelles l’UITS travaille au quotidien. Elles permettent les adaptations. Prenons par exemple le cas du dégraissage puisque la préparation de surface est un sujet qui intéresse la revue. L’UITS, dernièrement, a pu, avec l’aide de ses principaux partenaires, la FIM et le Cetim, faire modifier la réglementation - les rubriques ICPE - pour y intégrer la performance des machines de dégraissage solvants ou lessiviels. Une belle illustration du principe gagnant/gagnant. Notre profession se doit de monter en gamme : une valorisation des actions de R&D et des avancées technologiques est essentielle. Les alliances technologiques et stratégiques avec les pôles de compétitivité et le Cetim, centre technique national, seront essentielles, à mon sens, pour parvenir à ce positionnement d’excellence. Le traitement des matériaux, qui englobe le traitement des surfaces et le traitement thermique, est une étape majeure et incontournable de l’industrie – il faut le faire savoir ! L’UITS, syndicat du traitement des surfaces, doit être le reflet de cette spécificité. Il faut notamment insister sur l’implication de nos métiers dans le développement durable. En effet, en augmentant la durée de vie des pièces traitées, le traitement des matériaux contribue au développement durable. Pour répondre à ce nouveau concept, je souhaite proposer la mise en place d’une charte de développement durable, véritable référentiel de l’action environnementale de la profession, qui serait connue et reconnue par l’ensemble de la profession mécanicienne. On observe de plus en plus de regroupements d’entreprises sur le territoire. Des entreprises saisissent également des opportunités de se développer à l’international. Il est nécessaire de soutenir ces entreprises dans cette démarche de regroupement et de conquête de l’International. Cette ambition est possible avec le soutien et l’implication de tous. Pour conclure, je reprendrai la devise développée devant les administrateurs de l’UITS, le 17 octobre 2012, lors de mon élection à la présidence : « Aider les adhérents à créer de la Valeur, au travers des bouleversements de la décennie ».
Edouard Serruys, président de l’UITS.
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°422 - Mai/juin 2013
50 ans aux côtés de Traitements & Matériaux
Ma carrière professionnelle a commencé en 1963, avec la revue Traitement Thermique, c’est dire si elle m’a accompagnée. Comme beaucoup de mes collègues, j’attendais avec intérêt et impatience, l’arrivée de chaque nouveau numéro. Des séries d’articles de fond (comme les bases du traitement thermique) et des fiches pratiques étaient imprimés sur des feuillets détachables, permettant de les rassembler avec assiduité dans une collection. Dès les débuts, les hommes de terrain (Alphonse dans l’atelier) et les techniciens et ingénieurs (en blouse blanche au labo) se sont « chamaillés » sur le contenu des articles, trop théoriques pour Alphonse (surtout pas de formule !) ou trop pratiques pour les scientifiques. Sans avoir été clairement définie, la ligne éditoriale était que la revue soit lue dans l’atelier. Les rubriques « fiches pratiques », « calepin du professionnel », « cas concret » en était la garantie. Le magazine a pris une autre influence après la création de l’ATTT en 1969. Son rédacteur en chef André Cadilhac (ancien directeur des méthodes à la RNUR) avait grandement joué de son influence pour que l’ATTT se crée. Dès lors, revue et association seront étroitement liées, avec un très grand soutien de Pyc Édition pour l’ATTT les premières années. Les activités de l’association seront largement relayées par la revue. Les successeurs d’André Cadilhac comme rédacteurs en chef industriels seront Jacques Marty et René Caulé tous deux présidents de l’ATTT. René Caulé sera remplacé par une journaliste, Claudie Cabourdin, en 1997, puis par Béatrice Becherini, en 2004 ; la caution industrielle éditoriale sera alors assurée par le « conseiller de la rédaction ». Les membres du comité de rédaction seront majoritairement des personnalités de l’association. À l’exception d’une courte période durant un changement des actionnaires de Pyc Édition, il n’y aura pas de conflit entre la revue et l’association sur la ligne éditoriale. Les grandes étapes sont les modifications de couverture, de mise en page et de titres (dont je suis à l’origine) comme vous le découvrez dans ce numéro. Nous avons cherché par ces changements de titre, à accompagner les évolutions de nos métiers, comme ce le sera également pour l’association (ATTT – A3TS). Bien que cette revue soit considérée par la communauté scientifique comme une revue de référence pratique, sa présence dans les références bibliographiques montre qu’elle est une véritable source de données sur les traitements thermiques. Souhaitons qu’elle soit pour l’avenir une référence sur les traitements et matériaux.
Claude Leroux, conseiller de la rédaction.
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°421 - Mars/avril 2013
La résignation n’est pas une option
La crise a bon dos, elle est prétexte à tout. Elle est même opportune pour les tenants d’un néolibéralisme sauvage dont la logique a conduit à une débâcle économique mondiale qui dure et continue de faire des dégâts. Pour enrayer les manques à gagner, nos gouvernants partent sur une logique de fuite en avant par l’imposition sur les individus mais surtout sur les entreprises dont l’effet conduit à une délocalisation de production ainsi que des sièges sociaux. Les fournisseurs de biens d’équipement subissent de plein fouet ce marasme auquel s’ajoutent les contraintes de financement, de législation de fabrication ainsi que les procédures obligatoires et incontournables pour la fourniture d’une machine. En partant d’une certification d’entreprise (ISO, SQS, OHSAS, Nadcap), passant par celles des moyens (AMS 2750, CQI9, CE, EN 746), ou aux procédures de contrôle et montage d’installations chez le client final (PPS, CHST), nous avons mis en place des « usines à gaz » qui demandent des investissements humains conséquents et dont l’utilité est souvent discutable par rapport à la destination finale du produit. D’autre part le client demande toujours plus en établissant des cahiers des charges drastiques à base de clauses juridiques, de pénalités à chaque échéance du projet, de « performance bond », de service en hotline et de garanties étendues, sans accepter de répercussions financières. Toutes ces contraintes ne sont pas automatiques dans le grand export vers les pays émergents (BRIC) ni même vers certaines nations européennes dont l’Allemagne qui privilégie les relations fournisseur/client et a trouvé un certain équilibre dans ses exigences techniques. Il est vrai que l’industrie est le moteur de son économie, que le syndicat IG Metall dialogue constructivement avec le patronat, et les chefs d’entreprises rencontrés se battent pour garder l’emploi, construisent ou s’équipent pour être prêts… à la reprise… Paradoxalement la société française semble résignée, nous avons des ingénieurs qualifiés, des industries de pointe, un savoir faire, et nos centres de compétences s’orientent vers des techniques prometteuses. Arrêtons de gamberger, prenons confiance dans nos actions et décisions, retrouvons une culture d’entreprise optimiste et réaliste, soyons combattifs par rapport à la concurrence internationale, et surtout rationalistes et pragmatiques dans le déroulement de nos projets en investissant dans l’outil en adéquation à la demande ; tout le monde en sortira gagnant.
Daniel Zimmermann, directeur technique des fours industriels CODERE SA
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°420 - Janvier/février 2013
Oser l’export
De retour d’un de mes nombreux voyages en Asie, je me rends compte une nouvelle fois de l’incroyable paradoxe dans lequel évoluent nos industries et mentalités. Ici on parle de crise, alors que le mot mutation devrait plus sagement être utilisé, on menace de fermer des sites complets et faire disparaître le tissu social et industriel associés… Là-bas c’est l’effervescence, les usines s’agrandissent ou se créent à une cadence qui ressemble sans doute à ce que nos parents ont connu pendant les « 30 glorieuses ». L’eldorado qui bouillonne à moins d’une demi-journée d’avion de Paris nous tend les bras.
Toutes les études démontrent que les entreprises exportatrices résistent beaucoup mieux aux crises économiques… Certains de nos voisins l’ont compris bien avant nous et « chassent en meute » désormais. Hors nous avons aussi nos talents, nos produits sont appréciés au point qu’un de nos constructeurs de fours n’hésite pas à inscrire « made in France » sur ses équipements. Bien sûr, il ne s’agit pas de se lancer à corps perdu dans l’aventure de l’export mais de redoubler d’énergie, identifier ses forces et faiblesses, le marché le plus pertinent à prospecter, sélectionner le partenaire le plus fiable et la procédure adéquate. Il est vrai que le monde est vaste et qu’une PME a le droit de craindre les difficultés liées aux barrières linguistiques ou culturelles, au coût des opérations de prospection etc... Se poser ces questions, c’est déjà faire un pas vers une démarche constructive car, bien évidemment, elles ne peuvent pas être occultées. Je dirais même que je ne connais pas de PME ayant en son sein, la compétence pour aborder seule ces marchés. Hors il se trouve que notre pays met à disposition dans nos villes des organismes comme les Chambres de commerce qui disposent de bases déportées dans la plupart des capitales étrangères. Chacune d’entre-elle est prête à vous présenter un panel de partenaires (licenciés, agents, distributeurs…) sélectionnés à partir de votre cahier des charges et d’une analyse fine de votre problématique effectuée chez vous, par votre agence locale. Vous n’aurez plus qu’à les évaluer et faire votre choix… Les grands succès d’ECM Technologies à l’export sont tous le fruit d’une démarche volontariste et structurée. Ce que nous avons appris est qu’il ne faut jamais faire une confiance aveugle au hasard, la rencontre miraculeuse sur un stand de congrès est rarement le meilleur choix. Pire, il faudra plusieurs années pour se rendre compte que cet investissement n’était pas le bon. Outre votre argent évaporé, ce sont des parts de marché, peut-être stratégiques, que vous aurez laissé à vos concurrents. Osons donc l’export mais dans une démarche structurée pour qu’à chacune des étapes, nous ayons le sentiment d’avoir posé la meilleure des pierres. Je vous souhaite une très heureuse année 2013, toutes voiles gonflées vers le grand large !Alfred Rallo Directeur commercial d’ECM Technologies, Directeur d’ECM China
Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -
N°419 - Décembre 2012
Les moteurs de l’innovation industrielle
Innovation… Ce mot évoque spontanément des technologies de ruptures ou des produits high-tech. Mais dans la vraie vie industrielle, on ne fait pas un saut technologique tous les six mois, on ne révolutionne pas le marché tous les ans et pourtant, on innove quotidiennement. On innove dans les produits, mais plus encore dans les procédés. Comment moins polluer, réduire les coûts, accroître la performance du produit, répondre à tel nouveau marché ? Voilà les questions auxquelles l’industrie doit continuellement répondre, voilà ce qui l’oblige à une activité intellectuelle intense et perpétuelle, voilà les moteurs de l’innovation au quotidien. Et voilà pourquoi, malgré maintes difficultés, travailler pour l’industrie est passionnant. Parmi les sujets traités dans le dossier du dernier numéro de l’année 2012 : la combinaison des traitements de surface. « Combinaison », un mot à la source de bien des innovations. Comment combiner les performances fonctionnelles, économiques et environnementales d’un traitement ? En attendant une fantasmatique solution unique et miraculeuse, il faut combiner, croiser, adapter les traitements au plus près du besoin. Ceci implique aussi une définition de plus en plus précise de ce besoin, une personnalisation plus poussée des traitements et à toutes ces étapes, de l’imagination et de l’innovation. Autre exemple : le développement d’une « méthode de caractérisation simple et rapide basée sur l’essai standard de dureté par pénétration ». « Simple » et « standard »… a priori pas très glamour et incongru quand on parle d’innovation. Et pourtant, inventer un procédé « simple et standard » pour rendre compte d’une réalité complexe, voilà qui est innovant ! Et il est certain que ce développement a mobilisé l’imagination et la passion nécessaires à toute innovation. Dans le premier cas on crée un procédé complexe. Dans le second cas on simplifie. Dans tous les cas on innove. Ces deux exemples sont emblématiques de l’innovation continue en œuvre dans nos usines, loin des feux de la rampe. à l’heure où, enfin, on redécouvre la nécessité impérieuse d’une industrie forte et performante et où le mot « innovation » est scandé comme la martingale qui viendra à bout de toutes nos difficultés, il est opportun de donner un coup de projecteur sur quelques procédés innovants qui contribuent, quoiqu’on en dise, à maintenir notre industrie à un haut niveau.
Jean-Marc Popot, directeur général CRITT-MDTS.
Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -
N°418 - Octobre/novembre 2012
L’environnement, moteur de l’innovation
Lorsque l’on parle de traitements de surface on fait appel à de multiples domaines et technologies visant à modifier les propriétés surfaciques des matériaux traités. Chaque domaine regorge de créativité pour s’adapter aux évolutions des besoins de l’industrie et à celles des contraintes législatives qui encadrent ces activités. Un des moteurs de l’innovation est alimenté par les contraintes environnementales qui poussent les industriels du secteur à adapter les procédés existants pour les rendre moins polluants. Ces contraintes incitent également les industriels à développer des technologies et des procédés produisant peu d’effluents. Parallèlement, des dépôts de nouveaux matériaux sont mis au point ou se démocratisent afin d’améliorer le rendement des systèmes mécaniques et de prolonger la durée de vie des composants pour réduire les émissions de polluants et de déchets. Pour les applications mécaniques, l’ajustement des propriétés en sous-couche fait également partie des gisements d’innovation avec notamment un certain nombre de travaux portant sur l’optimisation du couplage entre des traitements thermiques ou thermochimiques et des traitements de surface. Ce numéro de Traitements & Matériaux vous permettra de vous faire une idée de ces évolutions au travers du compte-rendu du congrès A3TS qui s’est déroulé les 6 et 7 juin derniers à Grenoble. Vous retrouverez également des articles illustrant la tendance, avec l’émergence des revêtements DLC à haute adhérence ou les études visant à mieux cerner l’intérêt tribologique des nitrocarburations. Vous pourrez également vous pencher sur les perspectives qu’offre le procédé de projection plasma de suspension. Bonne lecture.
Stéphane Chomer, directeur technique, Thermi-Lyon
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°416 - Mai/juin 2012
L’innovation, la clef du succès
À l’ère de la réduction de la consommation d’énergie, les fours ne sont pas épargnés et évoluent de façon permanente pour s’adapter aux contraintes économiques et environnementales toujours plus fortes. La recherche de performances accrues associée à la baisse de la consommation énergétique reste un des axes de développement majeur qui permettra à nos entreprises de rester compétitives face à la concurence mondiale. Le marché de la fibre optique illustre fortement cette voie. Les fours semi-continu « traversants » - chauffés par induction à 2 100 °C par rayonnement thermique sur une préforme de verre de différents indices pour former la fibre - ont vu leur consommation énergétique réduite de 18 à 23 % selon la gamme. L’utilisation de nouveaux matériaux isolants et une conception améliorée par simulation numérique ont permis ces avancées. Les technologies traditionnelles avec des fours résistifs, des fours à gaz, ou encore les technologies par induction qui permettent de limiter la consommation énergétique au juste nécessaire suivent le même élan. La fusion, le chauffage avant forgeage, la préchauffe, la cémentation, la nitruration, les traitements sous vide, le frittage, le traitement thermique (recuit, revenu ou trempe), le brasage, l’élaboration de matériaux complexes ou encore la purification des matériaux font partie des applications des fours les plus courantes. Mais la liste est loin d’être exhaustive et les demandes, de plus en plus exigeantes pour des produits de plus en plus performants, conduisent à élargir les champs d’applications et à développer de nouvelles technologies. Certaines technologies encore très peu connues telles que les fours à plasma d’induction ont un avenir prometteur pour l’élaboration de matériaux de haute pureté. Une même volonté anime les innovations : l’augmentation de la qualité des pièces produites dans les fours et la diminution des coûts de production dans le respect toujours plus fort des contraintes environnementales et des conditions de travail. Les procédés sont de plus en plus pointus afin d’optimiser les rendements. Les matériaux sont améliorés et ajustés plus précisément aux besoins réels. La mixité des solutions technologiques est une dynamique d’avenir. L’association de technologies différentes sur une même étape pourrait conduire dans certains cas, à gagner en productivité et à améliorer les performances globales des procédés. Une plus large utilisation du chauffage par induction en association avec des fours sous vide permettrait de bénéficier des avantages spécifiques de l’induction tels que la rapidité de chauffage et la localisation précise de la chauffe. Le monde des fours industriels est en évolution permanente, le succès de nos entreprises dépendant avant toute chose de leur capacité et celle de nos laboratoires de recherche publics ou privés à développer des solutions innovantes en phase avec les besoins des marchés.
Guillaume Lecomte, responsable R&D, département Procédés & Solaire, EFD-Induction
Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -
N°415 - Mars/avril 2012
« Savoir, c’est prévoir pour agir »
En ouvrant les pages de cette revue professionnelle, vous avez choisi de consacrer du temps à la lecture de Traitements & Matériaux et vous avez raison. Une enquête réalisée fin décembre par l’Ifop pour le compte la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) souligne en effet la très forte valeur d’usage de la presse professionnelle. Ainsi, 89 % des lecteurs interrogés ont jugé les médias professionnels « utiles dans l’exercice de leur métier », alors qu’ils sont 78 % à leur attribuer un véritable rôle de formation. Par ailleurs, 92 % des sondés ont affirmé que la presse professionnelle est « crédible et fiable », alors que la presse dans son ensemble n’est jugée « fiable » que par 51 % des Français, selon le baromètre La Croix/TNS. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, si la crédibilité globale de l’information sur le web demeure faible (37 % selon La Croix/TNS), elle atteint 94 % pour les sites de presse professionnelle, selon l’étude FNPS/Ifop. L’utilité des informations délivrées par un média professionnel ne fait donc aucun doute pour ceux qui le lisent. Pourtant, certains d’entre vous ne sont pas encore abonnés au magazine que vous tenez entre vos mains et ne peuvent donc accéder aux services qui leur sont réservés sur le site www.traitementsetmateriaux.fr. Alors que nous entamons, avec l’A3TS *, une vaste campagne d’abonnement auprès des professionnels du métier, il nous a semblé utile de vous rappeler qu’en rejoignant nos fidèles abonnés, vous réaliserez un choix judicieux pour votre réussite professionnelle et le développement de votre entreprise. Un investissement pertinent à valeur ajoutée, encouragé par cette citation du philosophe Henri Bergson : « savoir, c’est prévoir pour agir ».
Jean-Christophe Raveau, directeur de publication
Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -
N°414 - Janvier/février 2012
Regarder l’avenir avec confiance
Nous abordons cette année 2012 en plein paradoxe. Il n’est pas un jour sans qu’on nous rappelle la récession dans laquelle l’industrie française devrait plonger en 2012. Et pourtant beaucoup d’éléments doivent nous amener à regarder avec confiance au-delà. Toutes les économies font face à de formidables défis dont une demande mondiale d’énergie en forte croissance et une irrépressible croissance de la demande de transport. Dans le même temps, les contraintes associées au réchauffement climatique et à la rareté des ressources énergétiques et de matières premières imposent une réorientation du modèle de développement économique, industriel et sociétal vers une gestion raisonnée des ressources naturelles. Face à ces enjeux, les technologies des matériaux et de leurs traitements vont vivre une véritable révolution. L’industrie aéronautique a déjà engagé la sienne, l’industrie automobile nous a présenté lors du Cimatts dernier à Metz les enjeux matériaux et traitements à l’horizon 2020. C’est l’ensemble des composants et systèmes de nos véhicules qui vont ainsi être revisités pour aller vers un mix matériau qui fera la part belle aux alliages légers, thermoplastiques et composites. évoquons aussi le programme français de création d’une filière de production pour les EMR - énergies marines renouvelables. Renforcement des propriétés mécaniques combiné avec allègement généralisé, amélioration de la protection anticorrosion, réduction des frottements générateurs de déperdition d’énergie, assemblages de matériaux hétérogènes, réduction de l’impact environnemental dans les procédés sont ainsi devenus le langage commun des centres de recherche, bureaux d’études et cellules d’industrialisation. L’industrie française et ses filières d’excellence – énergie, aéronautique, transports terrestre - possède de solides atouts pour jouer un rôle dans cette révolution des matériaux. Mais l’ampleur des challenges technologiques qui sont devant elle et l’imminence des échéances imposent une mutualisation des ressources et une approche collaborative entre les acteurs : grands donneurs d’ordres, ETI (entreprises de taille intermédiaire) et PMI, industrie et filières de formation, centres techniques et organismes de recherche. Saluons ainsi la création des deux IRT « M2P » et « Jules Vernes » portés respectivement par les pôles Materalia et EMC2. Un facteur clé sera la capacité de ces filières à attirer des talents, ingénieurs et techniciens, pour réaliser les programmes d’innovation et de développement technologiques. Les entreprises doivent largement communiquer vers les jeunes et les étudiants autour des carrières et des formidables aventures industrielles qu’elles proposent. Rarement dans le passé autant d’industries n’ont eu devant elles des défis technologiques de cette ampleur. Sachons exploiter ces opportunités pour en faire l’un des moteurs de la croissance française.
Pierre Bruchet, vice-président de l’A3TS
Accès au sommaireDossier - Technique