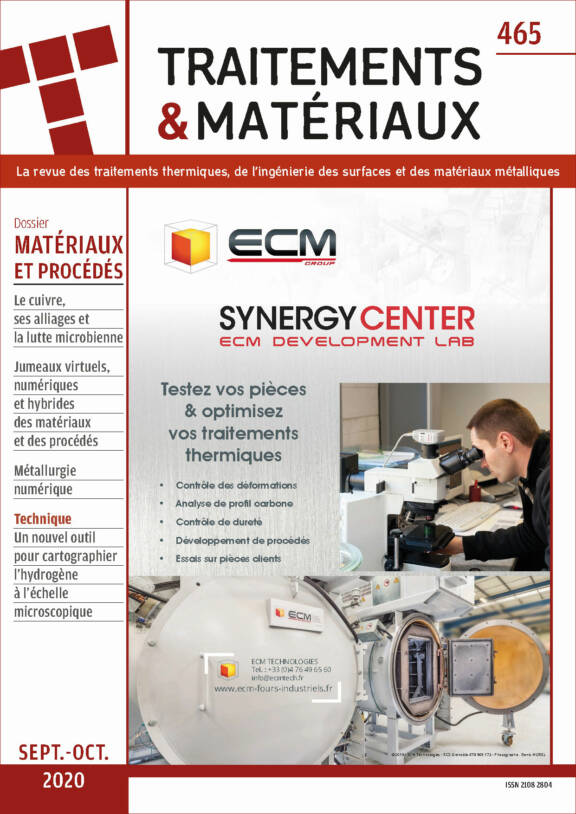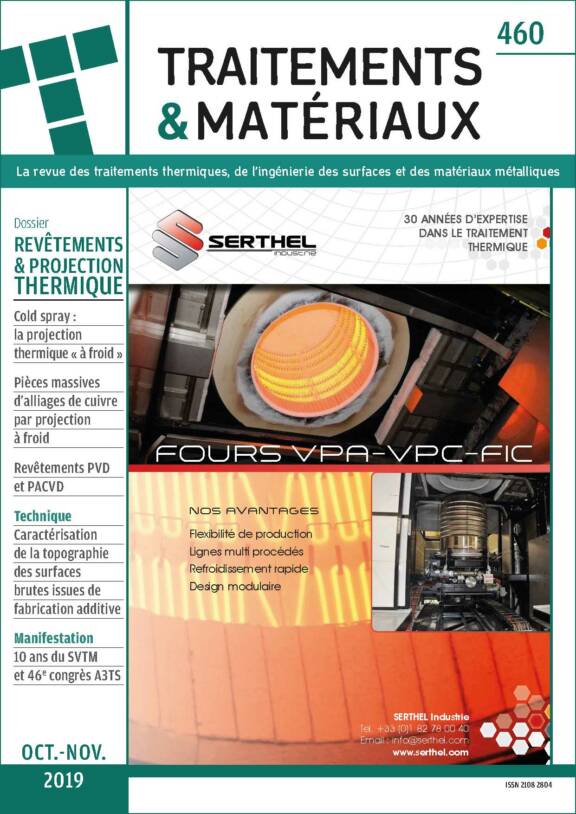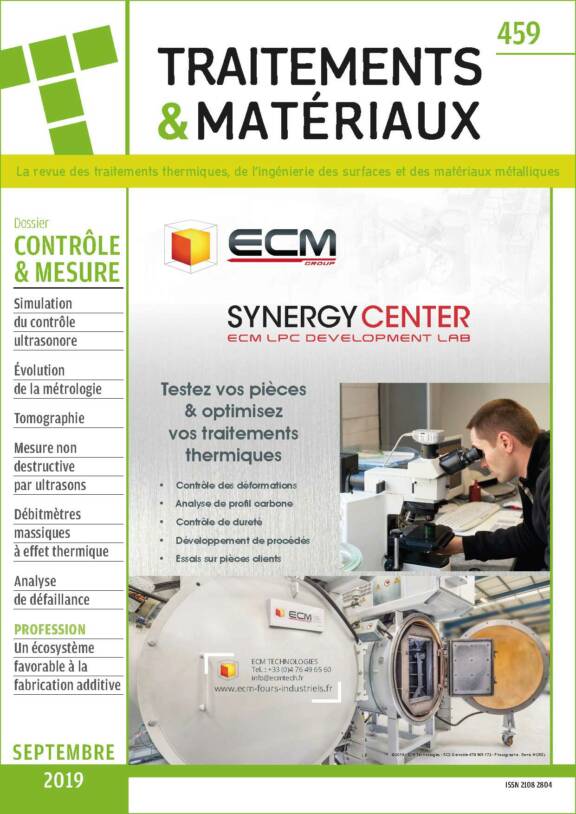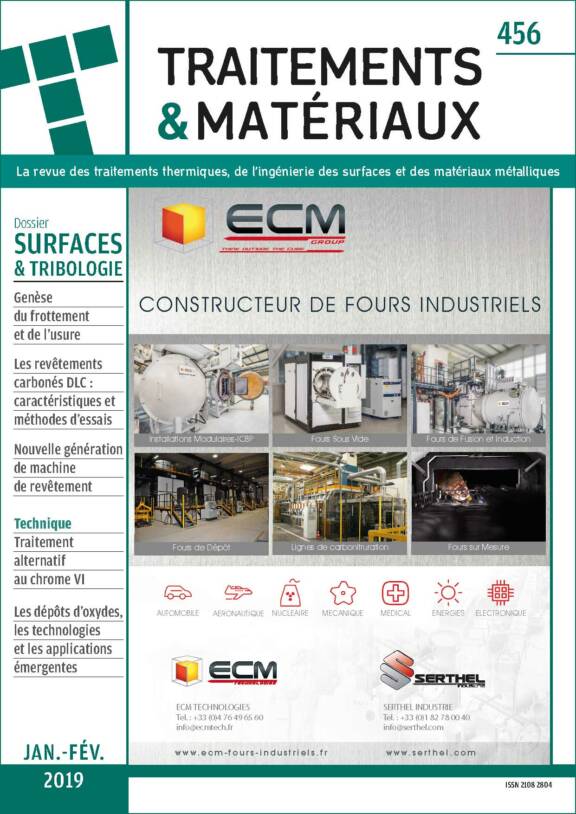Nos publications
-
N°466-467 - Novembre/décembre 2020
Les surfaces multifonctionnelles et adaptatives : une clé pour la transition environnementale !
La surface délimite l’interface d’un matériau de son environnement et son comportement définit l’intégrité et la durabilité du matériau. Depuis toujours, les traitements de surface et revêtements sont utilisés exclusivement pour des raisons esthétiques ou de protection contre les agressions environnementales et augmenter la durée de vie des pièces. Cela ne suffit plus et l’on attend aujourd’hui d’une surface qu’elle soit multifonctionnelle. Elle doit protéger simultanément d’au moins deux agressions ; par exemple l’érosion et le givre, la corrosion combinée à des propriétés auto-réparatrices ou l’isolation électrique tout en diffusant la chaleur… Depuis quarante ans environ, les matériaux connaissent une évolution, progressive, étonnante et considérable ! Les progrès accomplis dans le contrôle de la matière, jusqu’au nanomètre, sont considérables et permettent d’étendre les propriétés des matériaux au-delà des limites connues car les phénomènes chimiques et physiques d’interfaces deviennent alors prépondérants. Ces avancées se traduisent également dans le langage. De surface fonctionnelle, nous sommes passés à multifonctionelle, jusqu’au matériau adaptatif apparu depuis à peine dix ans. Ces deux derniers aussi appelés « smart materials », sont souvent confondus, alors que les propriétés d’un matériau adaptatif sont modifiées sous l’action d’un stimulus extérieur. Les surfaces adaptatives permettent déjà de détecter des dommages internes au substrat (impact, surchauffe, corrosion…) pour le contrôle santé des matériaux, ou d’adapter la consommation d’énergie d’un bâtiment par la régulation de température, via des surfaces électrochromes ou photovoltaïques. Les combinaisons possibles sont infinies et la montée en maturité de ces nouvelles surfaces permettra par exemple de produire, récupérer ou stocker l’énergie mais aussi d’améliorer le suivi en service des matériaux, d’optimiser la conception des produits, ou de prédire le potentiel de vie d’une pièce afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Le contexte de la crise actuelle est très complexe et incertain pour toute la chaîne de valeur. Cependant, son ampleur sans précédent, précisément à la croisée des chemins qui l’accompagnent, est particulièrement propice au changement de paradigmes. Les innovations, encore irréalistes il y a quelques mois, deviennent les matériaux différenciants des produits de demain. Ce moment est l’opportunité de se focaliser sur la maturation de ces nouvelles générations de surfaces, clés technologiques pour accélérer la transition environnementale !
Sophie Senani, chercheuse – experte en revêtements & surfaces, Safran Tech
Accès au sommaireProfession - Dossier -
N°465 - Septembre/octobre 2020
Des défis à relever
2020 est une année qui n’a épargné aucun d’entre nous. À l’heure où les feuilles jaunissent, il n’est pas encore temps de tirer le bilan de cette année mais une chose est certaine, nous avons tous beaucoup appris de la situation et elle a mis en évidence de nombreux défis à relever. À titre personnel, la présidence de l’A3TS, à laquelle j’ai l’honneur d’avoir été désignée en septembre dernier est clairement LE défi de l’année. Toutefois, ce n’est pas de moi que je voulais vous parler aujourd’hui mais bien du secteur des traitements des matériaux en général, et de l’A3TS en particulier. En effet, depuis mars, notre façon de travailler et d’interagir a été remise en question : télétravail, masques, téléconférences plutôt que visites de clients et fournisseurs, chômage à temps partiel… sont maintenant notre quotidien à tous. Tout cela nous pousse évidemment à la remise en question.
En remettant en question ses pratiques, l’A3TS a relevé le défi de la réinvention dans la continuité. Comment ? Tout d’abord en développant un catalogue de formations à distance, accessible depuis le mois de mai, qui a permis à plus de 70 personnes de parfaire leurs connaissances des traitements des matériaux. À partir de 2021, la plupart de nos formations seront proposées en présentiel et en ligne, permettant ainsi aux industriels de choisir la formule qui convient le mieux aux besoins et disponibilités de leur personnel. Mais l’A3TS, ce sont également des événements : congrès, salons, journées techniques… Malgré l’annulation du congrès annuel, nous revenons donc cet automne avec deux événements majeurs dans des formules inédites. Tout d’abord, les deuxièmes Journées Tribologie et Traitement de Surface (J2TS) se tiendront à Saint-Étienne ces 12 et 13 octobre avec une participation possible à distance. Ensuite, juste après cet événement, nous aurons le plaisir d’organiser, en visioconférence, l’European Conference on Heat Treatments (ECHT 2020), en collaboration avec nos amis de l’association Belgo-Néerlandaise de traitement thermique VWT. Comme vous le voyez, malgré la crise et le changement de direction, l’A3TS garde le cap et continue à fournir à ses membres des événements et un réseau de qualité. Dans le contexte actuel, où les mutations technologiques des filières du transport, de l’énergie, de la santé… ne cessent de s’accélérer, les missions de l’A3TS – diffusion de l’information technologique et le réseautage entre acteurs académiques et industriels - sont plus essentielles que jamais. J’espère rencontrer bon nombre d’entre vous lors de nos prochains événements et vous fixe d’ores et déjà rendez-vous en juin, à Marseille pour notre congrès annuel.Véronique Vitry, présidente de l’A3TS
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°464 - Juin 2020
Le média salon est irremplaçable
À l’instar du salon de l’agriculture qui fédère l’ensemble des acteurs des filières du monde agricole, Global Industrie est devenu en une seule édition un incontournable de l’industrie. Si en 2018, la profession voyait naître le premier événement français regroupant l’ensemble de l’écosystème industriel hexagonal et européen qu’elle appelait de tous ses vœux depuis des années, c’est que toutes les conditions étaient réunies : l’indispensable appui des pouvoirs publics qui lui a longtemps fait défaut, et une conjoncture économique propice, porteuse de business. La crise sanitaire et économique sans précédent que nous traversons a changé la donne.
Suite à la directive gouvernementale, et dans un souci de sécurité sanitaire, il nous a été impossible de maintenir notre édition 2020. Or, un événement tel que Global Industrie est la preuve vivante que le média salon est irremplaçable. En un seul lieu, le professionnel trouve une offre exhaustive de produits, solutions et services, représentative de tout l’écosystème industriel depuis les fabricants de machines jusqu’aux sous-traitants, en passant par les démonstrateurs (start-up, équipementiers, sous-traitants, donneurs d’ordres et grands groupes), et toute la chaîne de valeur (R&D, conception, production, services, formation). Le monde des affaires a besoin de se rassembler pour partager, construire, concrétiser. Aucun outil digital n’égalera le plaisir qu’il y a à signer un contrat, une commande ; à échanger avec un prospect ; tester du matériel, comparer des solutions, s’exercer sur des démonstrateurs, observer des centaines de machines en fonctionnement, découvrir des animations uniques telles que L’Usine Connectée qui tire l’industrie vers le haut, séduit des milliers de visiteurs et participe à diffuser une plus belle image de l’industrie auprès des jeunes qui ont été près de 8 000 à venir sur place… Seul un salon offre une telle richesse d’expériences. C’est pourquoi, dès 2021, Global Industrie se réinventera sans rien renier de son ADN et de ses valeurs. Fidèle à sa vocation de rassembler les acteurs de la filière et d’œuvrer au rayonnement de toute la chaîne de valeur, il sera un acteur capital de la relance économique et industrielle française. Du 16 au 19 mars, le salon retrouvera les terres lyonnaises, fertiles s’il en est pour l’industrie, comme on l’a encore constaté en 2019 où la première édition lyonnaise a dépassé les prévisions en accueillant plus de 45 850 visiteurs. D’ici là, Global Industrie ne lâchera pas tous les professionnels qui lui font confiance. Du 30 juin au 3 juillet prochains, Global Industrie Connect leur permettra d’entretenir les liens établis et d’en initier de nouveaux, dans une version virtuelle plus light.Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°463 - Mars/avril 2020
La continuité de l’information est assurée
C’est dans un contexte particulièrement troublé que nous bouclons ce numéro de Traitements et Matériaux. À l’heure où une grande partie des Français et des salariés sont confinés à leur domicile, la rédaction souhaite témoigner de son soutien et de sa solidarité à l’ensemble de ses lecteurs. Les équipes de Pyc Média sont mobilisées pour assurer la continuité de l’information sur les sujets qui vous passionnent. Durant cette période, Traitements et Matériaux entend, plus que jamais, jouer son rôle d’animation des communautés de métier. À tout moment, sur notre site web www.traitementsetmatériaux.fr vous pourrez retrouver toute l’actualité du secteur ainsi que les dossiers parus dans les précédents numéros du magazine, sur des sujets tels que la fabrication additive, les traitements de surface, les fours et équipements ou encore le contrôle et la mesure. Vous pouvez également nous suivre sur la page Linkedin dédiée à la revue Traitements et Matériaux et nous poser vos questions ou nous proposer des sujets, en m’envoyant un message par ce biais. Comme vous le savez, une newsletter est envoyée toutes les deux semaines afin de vous proposer un récapitulatif de l’actualité du secteur. Nous mettons tout en œuvre pour poursuivre sa diffusion et vous invitons, si ce n’est pas déjà le cas, à vous y abonner gratuitement via notre site web, à la rubrique « S’inscrire aux newsletters ». La rédaction souhaite maintenir le lien avec vous et vous apporter toute l’information nécessaire aux métiers du traitement des matériaux.
Béatrice Becherini, rédactrice en chef, Traitements et Matériaux
Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -
N°461 - Décembre 2019
Design et matériaux : ne pas oublier la fabrication !
Il y a quelques années une société allemande a conçu un réacteur nucléaire à eau bouillante. Ce réacteur résultait d’une grande expérience acquise au préalable. Le design était bon, les matériaux choisis intelligemment et fiables. Tout semblait aller au mieux jusqu’à ce que quelqu’un se rende compte que les gros forgés nécessaires à la fabrication de la cuve du réacteur étaient impossibles à forger car trop gros par rapport aux capacités mondiales des forges libres.
De même l’usinage d’acier inoxydable austénitique peut conduire le matériau à une plus grande sensibilité à la corrosion sous contrainte, ou à la fatigue, à cause d’une déformation importante en surface. Il en est de même pour le soudage.
Ou bien encore, le moulage de grosses pièces en acier austéno-ferritique peut mener à la fragilisation de la pièce par vieillissement thermique de la phase ferritique. Ce phénomène conduit au remplacement des coudes de tuyauterie primaire des réacteurs nucléaires.
Ces exemples nous rappellent que les choix des matériaux devant remplir une fonction spécifique pour un design donné, ne peuvent se faire qu’en ayant pris en compte en parallèle la technique de fabrication la plus adaptée. La fabrication peut en effet profondément modifier les propriétés des matériaux et limiter les dimensions ou les formes de composants.
La « mode » de l’impression 3D ou fabrication additive, semble soutenir l’idée qu’avec la bonne nuance de matériau on pourrait accéder grâce à cette technique à une gamme très importante de composants. Or, dans le monde industriel, cela n’arrive pas aussi aisément. Le matériau qui résulte de cette technique n’est pas forcément capable de remplir la fonction pour laquelle on l’avait choisi. Il n’y a d’ailleurs pas de pièces de structure qui soient actuellement fabriquées industriellement en impression 3D dans l’aéronautique, l’automobile ou l’énergie.
En conclusion, il est important d’avoir le réflexe d’associer au matériau la technique de fabrication choisie pour le composant et de se poser la question de l’influence de cette technique sur les propriétés en service du matériau sélectionné.Jean Dhers, R&D Manager, Framatome
Accès au sommaireProfession - Dossier -
N°460 - Octobre/novembre 2019
L’ISO/ASTM 52911-1-2019 marque un pas dans la fabrication additive
Depuis de nombreuses années maintenant, les machines de fabrication additive « 3D » ont envahi les laboratoires, les centres techniques, les plateformes d’innovations partagées, puis les usines. L’extraordinaire engouement pour ces technologies ne doit pas cacher les difficultés qu’elles ont à atteindre le stade de la production industrielle. Le marché des machines B to B pour applications domestiques marque le pas et, à titre d’exemple, en dépit des avancées technologiques de la fabrication 3D de pièces métalliques, bien peu de pièces aéronautiques produites en fabrication additive volent, compte tenu de la longueur des processus de qualification. Le terme « fabrication additive » recouvre des familles de technologiques variées, on compte plus d’une demi-douzaine de technologies additives. Le dénominateur commun de ces technologies est d’agréger la matière (poudres, fils…) par rapport aux technologies de production traditionnelles, qualifiées alors de « soustractives ».
En dépit de leurs atouts (design flexible, réduction des temps de mise en production, allégement des pièces…) il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ces technologies « additives » puissent s’imposer comme des solutions standards et compétitives pour la production industrielle de série. Mais deux caractéristiques inhérentes à ces familles de technologies doivent nous convaincre que, en dépit des challenges technologiques et industriels posés, ces technologies s’imposeront dans de multiples applications et domaines. En effet, elles s’intègrent tout naturellement dans l’univers numérique de l’Usine du Futur par leur recours massif aux technologies digitales et, par l’économie de matière et aussi d’énergie dans la mise en œuvre de cette matière, elles sont en adéquation totale avec l’orientation stratégique qui s’impose aux industriels vers des procédés qui réduisent les impacts environnementaux.
Si l’influence des fabricants de machine a été déterminante dans la phase d’amorçage des technologies additives, la mobilisation d’écosystèmes associant la chimie des matériaux, le monde du digital, les technologies de contrôle et les futurs exploitants… apparaît aujourd’hui essentielle pour atteindre le stade de la production industrielle. De nombreuses initiatives ont ainsi vu le jour en France (Additive Hub Factory, Aeroprint, AddimAlliance, Famergie…). La parution en juillet dernier de la norme ISO/ASTM 52911-1-2019 « Fabrication Additive – Conception - Partie 1 – Fusion sur lit de poudre métallique » est un événement majeur dans ce paysage. La fusion sur lit de poudre est en effet l’une des technologies additives les plus mûres, mais elle souffre bien évidemment d’un déficit d’expérience. Le savoir-faire a été longtemps confiné aux fabricants de machine, qui ont souvent développé des « boîtes noires » reposant sur des systèmes de contrôle fermés, ainsi qu’aux précurseurs, sociétés spécialisées ou équipes dédiées de quelques grands groupes. L’édition de la première norme un peu globale va contribuer à diffuser les bonnes pratiques au-delà du périmètre initial et sera de nature à accélérer l’émergence et la réalisation de programmes de développement débouchant sur des qualifications à grande échelle.
On en est encore qu’au tout début de l’histoire des fabrications additives.Pierre Bruchet, consultant
Accès au sommaireDossier - Technique -
N°459 - Septembre 2019
Une aubaine pour la mesure
Pas de répit avec la numérisation du monde et de l’industrie ! Nous consommons quotidiennement la modernisation du monde, et de son industrie. Déjà des balances, des tensiomètres connectés via bluetooth. Bientôt des voitures et des usines autonomes. Si notre industrie est passée de 25 % du PIB à 12 % en 30 ans, ce qu’il en reste n’a pas dit son dernier mot et aborde le futur avec la détermination des survivants. Pour avoir visité les fleurons industriels aéronautiques, navals, automobiles, ferroviaires, chimiques ou électroniques, il y a encore un savoir-faire industriel en France extraordinaire, qui n’a pas l’intention de réduire ses ambitions et c’est tant mieux !
Le défi de cette modernisation industrielle qui s’invite dans nos activités quotidiennes, consiste à piloter des centres de production 24 heures/24 et 7 jours/7 en automatique, avec un contrôle de la qualité des produits manufacturés, en ligne.
Les tolérances dimensionnelles des process ont été diminuées drastiquement au cours des 10 dernières années. Les épaisseurs d’or d’une carte à puce ont été divisées par 20. Autant vous dire qu’il n’y en a plus beaucoup, mais suffisamment pour téléphoner ou faire un retrait bancaire. La dorure dans l’industrie du luxe avec ses « flashs » d’or est devenue un process extrêmement exigeant, bien difficile à contrôler. Les peintures de nos automobiles sont devenues attrayantes avec des « rouges sang », des « bleus vertigineux » et des « noirs obscurs ». En même temps, les épaisseurs déposées par les robots, sont désormais au micron prêt. Pas d’improvisation ! Quant aux compositions des matériaux utilisés, toujours plus complexes, les nanomatériaux n’intègrent désormais que quelques traces de certains éléments, voire que quelques atomes.
La finesse de ces processus amène nos équipements de laboratoire à rejoindre la ligne de production pour un contrôle en ligne, voire une régulation des processus avec un contrôle « in the loop ». Ces régulations des processus de fabrication selon les mesures en lignes ne sont plus une virtualité mais une réalité. Aujourd’hui, les mesures de chacune des couches de peinture déposée sur une carrosserie seront mesurées en ligne et transférées aux robots de peinture, pour adapter les quantités déposées en temps réel. Les quantités d’or déposées sur les cartes à puces seront mesurées en fin de processus pour adapter le process en fonction des mesures. Et ainsi de suite. Nos équipements de laboratoire quittent leurs salles blanches pour rejoindre les lignes de production. Quel progrès ! Ils devront devenir plus fiables et plus robustes, plus compacts pour s’intégrer dans l’existant, plus communicants et plus abordables, parce qu’ils sont attendus partout avec un ROI parfois compliqué. Autant faire simple. Avec la digitalisation de l’industrie, ce sont des nouveaux marchés et de nouvelles applications qui sont proposés au secteur de la mesure. Réjouissons-nous !Thierry Vannier, directeur général Fischer France
Accès au sommaireProfession - Dossier -
N°458 - Mai/juin 2019
La finition de surface au service de la fabrication additive « 3D »
Safran a récemment annoncé la création d’une nouvelle usine de fabrication de pièces en fabrication additive 3D, au Haillan, en Gironde ; preuve de l’intérêt porté par Safran pour ces technologies. Elles offrent un potentiel important de développement de produits et de services innovants et sont une source de motivation pour les techniciens et ingénieurs. Elles élargissent le champ des possibles via une co-activité entre les métiers Matériaux, Procédé, Conception, Industriels, Qualité. Elles permettent de fabriquer des pièces avec des géométries complexes et de proposer un large spectre de matériaux. Par contre, le challenge est de garantir la qualité et la fiabilité des produits, tout en répondant aux enjeux environnementaux et en contrôlant les coûts. Ceci passe notamment par la maîtrise des états de surface. Il s’agit de :
• garantir les objectifs fonctionnels des pièces comme la tenue en fatigue ou la maîtrise des pertes de charge dans les transports de fluides. Ces caractéristiques dépendent des états « fin de process » de la pièce en tous points ;
• maîtriser les risques liés à la propreté des pièces tant au niveau industriel que pour garantir les exigences fonctionnelles.
Les limites de ces procédés pourraient constituer à terme un verrou si on ne développe pas une offre innovante en termes de finition de surface. La montée en maturité de ces procédés innovants devra intégrer la compréhension des mécanismes mis en jeu pour parachever les pièces. L’enjeu est de maîtriser d’un point de vue qualité les variabilités des procédés et leur impact sur les états de surface en tout point des pièces. Dans ce contexte, le développement du digital et des data science au travers de l’industrie 4.0 est une opportunité indispensable pour réussir, et cela au travers notamment de la simulation numérique, et des avancées de la « data science » appliquée aux procédés de fabrication. L’un des enjeux est de se doter de plans de surveillance robustes et contribuer ainsi à la maîtrise continue des objectifs qualité produit.
De facto, les voies à suivre pour réussir ces enjeux technologiques sont :
• d’optimiser les procédés de finition existants en s’appuyant sur la compréhension fine des mécanismes physico-chimiques mis en jeu, sur la simulation numérique et la data science ;
• de développer de nouveaux procédés de finition de surface ou combinaisons de procédés.
Les sujets à traiter sont complexes et nécessitent des compétences multiples comme la métallurgie, les traitements thermiques et de surfaces. Pour se faire Safran compte sur ses compétences internes, mais aussi celles des partenaires industriels, des instituts de recherche technologiques, des laboratoires académiques, et plus globalement les métiers en lien avec l’A3TS.Dr Martine Monin, chef du service Traitements et Ingénierie des Surfaces, Safran Tech
Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -
N°457 - Mars/avril 2019
L’A3TS célèbre ses 50 ans
C’est dans les années soixante qu’une poignée de professionnels décidaient dans un premier temps de créer la revue de Traitement Thermique puis une structure originale à mi-chemin entre société savante et organisation professionnelle qui deviendra en 1969 l’Association Technique de Traitement Thermique (ATTT). Même si les traitements thermiques sont au cœur de la fabrication des pièces mécaniques, les spécialistes qui en sont en charge étaient en effet peu nombreux et relativement isolés dans leur entreprise animée par les mécaniciens. Ils ressentaient un vif besoin d’échanger et de partager leurs expériences, dans un contexte d’évolution rapide des technologies.
L’ATTT était née. Très rapidement tous ceux qui sont concernés par les traitements thermiques, du fournisseur de matière et d’énergie, au constructeur d’équipement en passant par les animateurs d’atelier, les responsables de laboratoire, les centres techniques et de recherches, écosystème avant l’heure, rejoignirent l’ATTT. Dès la seconde année d’existence les journées nationales (futur congrès annuel) sont mises en place. Des sections régionales sont créées afin de permettre l’organisation de rencontres de proximité. Plusieurs réunions annuelles ont lieu à Paris et en Province, les échanges y sont très animés et très ouverts. Les sujets abordés via l’ingénierie des surfaces côtoient de plus en plus souvent le domaine des traitements de surface. L’association deviendra ainsi en 2005 l’Association de Traitement Thermique et Traitement de Surface (A3TS) et intégrera tous les procédés de traitement et revêtement de surface. Que de chemin parcouru par l’association en 50 ans ! L’Association a su s’adapter aux évolutions de l’industrie, se transformer par petites touches successives, en restant fidèle à ses fondamentaux : l’humain, l’industrie et la passion pour l’innovation technologique.
La motivation première était en effet de favoriser les contacts directs, aujourd’hui encore l’organisation d’événements reste la clef de voûte de l’A3TS. Les adhérents de l’A3TS partagent la conviction que l’industrie française doit continuer à occuper un rôle clé pour répondre aux grands enjeux du futur en combinant montée en gamme, audace, ambition internationale, innovation technologique et capacité à faire œuvrer dans un même but les acteurs des filières. Portée par le dynamisme, la complémentarité et l’enthousiasme de ses membres, l’A3TS restera une composante de l‘écosystème des filières des matériaux. Les challenges qui se posent à elle sont l’appropriation des technologies modernes de communication tout en maintenant la priorité aux contacts humains, l’intégration dans un environnement résolument international et l’élargissement des périmètres technologiques.
L’A3TS, à l’occasion de son 50e anniversaire, remercie ses partenaires et tout particulièrement son partenaire éditorial Pyc Média qui l’accompagne avec fidélité depuis ses premiers pas.Pierre Bruchet, A3TS
Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -
N°456 - Janvier/février 2019
Que serait un monde sans frottement ?
Pourrions-nous imaginer un monde sans frottement ? Comment nous déplacerions-nous ? Tous les objets et êtres vivants mobiles seraient contraints à s’entasser en bas de chaque dénivelé… De manière moins dramatique, impossible d’entendre le chant du criquet, ni celui du violon… Et pauvre Don Juan courant suspendre l’échelle au balcon (acte III, scène XV)... Celle-ci ne tiendrait plus appuyée contre le mur… Un monde sans frottement serait à coup sûr invivable. D’un autre côté, une étude récente et détaillée [Holmberg, in Friction 5(3), 2017] montre qu’environ 20 % de la consommation mondiale d’énergie (103 Exajoules !) sert à vaincre le frottement et 3 % (16 EJ) à la remise à neuf des pièces usées et/ou pour pallier les défaillances liées à l’usure, ce qui correspond à 3,5 % du Produit Mondial Brut.
Selon les situations, les niveaux de frottement et d’usure sont quelquefois voulus, élevés (freins, semelles, pneus…), quelquefois non (segments de piston, paliers, skis…), tout comme l’usure est parfois nécessaire (craies, surfaçage…) ou coûteuse (diverses pièces mécaniques). On comprend alors qu’actuellement, exacerbé par le développement des nanotechnologies où la surface prend une place prépondérante, le maître mot est devenu le contrôle du niveau du frottement et de l’usure, tout autant que la volonté de sa réduction.
La tribologie, science récente regroupant le frottement, l’usure et la lubrification (le mot est apparu en 1966, [HP Jost]), est encore trop peu enseignée pour de nombreuses raisons, mais l’une d’entre elles est qu’il est extrêmement difficile d’enseigner des phénomènes avec si peu de lois physiques générales et établies. La difficulté vient du fait que ni le frottement, ni l’usure ne sont des propriétés intrinsèques des matériaux qui subissent une sollicitation de contact.
Une des conséquences immédiates est que de nombreuses études ont permis d’établir un certain nombre de règles pour les constructeurs, mais, fortes de leurs succès, ces dernières ont été généralisées à tort : « Plus c’est dur, moins ça s’use ; plus c’est lisse, mieux ça glisse ; un frottement élevé provoque une forte usure… ». Ces résultats, justifiés dans des cas particuliers ont été ensuite utilisés à tort comme des postulats.
Le meilleur moyen de ne pas faire d’impair de la sorte serait de bien comprendre la source du frottement et de l’usure, et c’est là que le bât blesse ! Les causes du frottement, telles qu’on les comprend de nos jours, sont multiples et fortement interdépendantes. Si, avec plus ou moins de succès, la spéculation intellectuelle et les expériences ont permis d’avancer dans la compréhension des phénomènes, ce n’est que depuis le milieu du XXe siècle, grâce aux travaux de Bowden et Tabor (1950) que des idées plus claires ont été énoncées sur le sujet. Les conceptions plus modernes (tribologie des interfaces – notion de troisième corps) nées sous l’impulsion de Maurice Godet (1980) permettent de mieux rendre compte des phénomènes en considérant l’interface comme une zone à part entière dans le contact glissant, mais ne conduisent pas à un modèle mathématique utilisable dans les bureaux d’études. Malgré tout, celui qui se plongera dans ces modèles phénoménologiques pour les intégrer dans la conception de produits et/ou de systèmes pourra mieux optimiser ses contacts glissants pour favoriser ou non un bas niveau de frottement, favoriser ou non un faible taux d’usure.Dr Xavier Roizard, Responsable de l’équipe Tribologie, Fonctionnalisation et Caractérisation des Surfaces, Département de Mécanique Appliquée, Institut FEMTO-ST UMR6174, Besançon
Accès au sommaireDossier - Technique